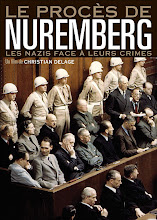Les adversaires d'Obama cherchaient la faille depuis plusieurs mois. La figure controversée du pasteur Jeremiah Wright, membre de l'église Trinity Church of Christ, qui avait marié Obama et baptisé ses filles, a ainsi été livrée en pâture à la presse américaine. Celle-ci, soudainement inquiète d'avoir été perçue comme trop favorable au challenger de Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate, a largement diffusé des extraits de sermons du pasteur appelant, entre autres, les Africains-Américains à préférer s'écrier "Que Dieu maudisse l'Amérique" au lieu de "Que Dieu bénisse l'Amérique".
Obama ne s'est pas contenté de prendre ses distances avec les propos de son pasteur. Il a cherché, ce qui est toujours périlleux, à les mettre en perspective en montrant comment certaines de ses déclarations étaient caractéristiques d'une génération pour qui les lynchages, les discriminations, les inégalités envers les Noirs constituaient une mémoire vive, et non un chapitre d'histoire scolaire ou savante.
Il a donc écrit et prononcé le 18 mars un discours dont Le Monde vient de publier de larges extraits en français. Cette "adresse" est bien plus et bien mieux qu'une simple manière de se désolidariser publiquement d'un ami devenu encombrant. Alors qu'il avait jusque-là évité de se présenter comme un candidat "communautaire", il a résolument choisi de prendre de front la question du "péché originel" de l'esclavage. Il l'a fait en rappelant comment l'idée de l'égalité civile ne s'est imposée qu'au prix de luttes successives qui se sont déroulées sur le temps long de l'histoire. Il aura fallu un siècle, de la guerre de sécession aux combats des années 1960, et "des générations successives d'Américains" pour que soit comblé "le fossé entre les promesses de nos idéaux et la réalité de leur temps".
Les paroles d'Obama ne sont pas des paroles d'évangile. Elles n'ont pas l'inflexion lyrique de celles de Martin Luther King. Ce ne sont pas non plus celles d'un "beau parleur", une critique qui lui a souvent été faite. On peut en discuter le détail, l'équilibre fragile entre la reconnaissance des violences subies par la communauté noire et l'appel à l'unité nationale, cet "être américain" censé dépasser les clivages identitaires et sociaux. Tel quel, ce discours est exemplaire d'une réhabilitation du politique après les mensonges de l'ère Bush. Pourquoi nous intéressons-nous autant, en Europe et ailleurs, à cette pré-campagne électorale ? Sans doute parce qu'elle permet au débat politique de se hisser, de temps à autre, à une hauteur que nous n'avons pas connue ici depuis longtemps.
Obama ne s'est pas contenté de prendre ses distances avec les propos de son pasteur. Il a cherché, ce qui est toujours périlleux, à les mettre en perspective en montrant comment certaines de ses déclarations étaient caractéristiques d'une génération pour qui les lynchages, les discriminations, les inégalités envers les Noirs constituaient une mémoire vive, et non un chapitre d'histoire scolaire ou savante.
Il a donc écrit et prononcé le 18 mars un discours dont Le Monde vient de publier de larges extraits en français. Cette "adresse" est bien plus et bien mieux qu'une simple manière de se désolidariser publiquement d'un ami devenu encombrant. Alors qu'il avait jusque-là évité de se présenter comme un candidat "communautaire", il a résolument choisi de prendre de front la question du "péché originel" de l'esclavage. Il l'a fait en rappelant comment l'idée de l'égalité civile ne s'est imposée qu'au prix de luttes successives qui se sont déroulées sur le temps long de l'histoire. Il aura fallu un siècle, de la guerre de sécession aux combats des années 1960, et "des générations successives d'Américains" pour que soit comblé "le fossé entre les promesses de nos idéaux et la réalité de leur temps".
Les paroles d'Obama ne sont pas des paroles d'évangile. Elles n'ont pas l'inflexion lyrique de celles de Martin Luther King. Ce ne sont pas non plus celles d'un "beau parleur", une critique qui lui a souvent été faite. On peut en discuter le détail, l'équilibre fragile entre la reconnaissance des violences subies par la communauté noire et l'appel à l'unité nationale, cet "être américain" censé dépasser les clivages identitaires et sociaux. Tel quel, ce discours est exemplaire d'une réhabilitation du politique après les mensonges de l'ère Bush. Pourquoi nous intéressons-nous autant, en Europe et ailleurs, à cette pré-campagne électorale ? Sans doute parce qu'elle permet au débat politique de se hisser, de temps à autre, à une hauteur que nous n'avons pas connue ici depuis longtemps.